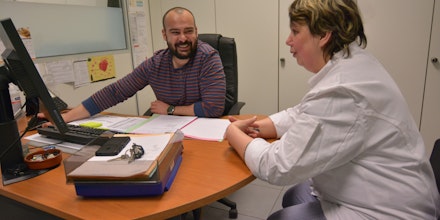Les SPIP participent à l'individualisation des peines privatives de liberté, ils aident à la préparation des décisions de justice à caractère pénal (1), des missions qui contribuent à la prévention de la récidive et favorisent la réinsertion sociale des personnes condamnées. Les SPIP interviennent tout au long du parcours judiciaire d’une personne condamnée
Qui est concerné par le suivi SPIP ?
Toute personne à qui le juge impose des obligations ou mesures de suivi dans le cadre d’une procédure pénale peut être suivie par le SPIP, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé.
Ainsi les personnes concernées sont :
- Les personnes prévenues (en attente de jugement) lorsqu’elles sont placées sous contrôle judiciaire avec obligations ;
- les personnes placées en détention pour préparer sa sortie de prison ;
- les personnes placées sous main de justice ;
o condamnées à une peine aménagée (bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur…) ;
o condamnées à une peine de sursis probatoire (anciennement sursis avec mise à l’épreuve) ;
o soumises à un travail d’intérêt général (TIG) ;
o condamnées à une libération conditionnelle ;
o placées sous surveillance judiciaire ou surveillance de sûreté après la peine.
Le suivi judiciaire par le SPIP : en quoi cela consiste-t-il ?
Le suivi judiciaire assuré par le SPIP repose sur un rôle combinant à la fois le contrôle et l’accompagnement. Via des entretiens réguliers avec un Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), le Service pénitentiaire d’insertion et de probation va en même temps vérifier que les obligations fixées par le juge sont respectées et aider la personne à construire un projet de réinsertion, à trouver ou garder un emploi, suivre une formation, se loger, accéder aux soins, gérer ses démarches administratives, etc.
Combien de temps une personne condamnée est suivie par les SPIP ?
La justice a pour but de pacifier la société. Pour cela elle va endosser plusieurs rôles dont celui de sanctionner les infractions, mais aussi, celui de permettre aux infracteurs de s’extraire de la délinquance afin de se réinsérer. Pour cela elle s’appuie sur les SPIP, ou Services pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont pour mission principale la prévention de la récidive. Les SPIP jouent ainsi un rôle essentiel d’aide à la décision judiciaire, de préparation à la sortie de prison et de suivi post-sentenciel.
Le suivi SPIP en pré-sentenciel
Ainsi avant le prononcé de la peine, en pré-sentenciel, les Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), à la suite d’échanges avec la personne incriminée vont pouvoir adresser au Juge d’application des peines des rapports à la préparation et à la mise en œuvre des condamnations pour l'aider à la prise de décisions judiciaires. Pour cela ils interrogent le quotidien de la personne : s’il exerce des responsabilités familiales, s’il a une activité professionnelle, s’il dispose d’un logement, quel est son positionnement par rapport à son infraction, quel est l’acte de délinquance commis, s’il est en état de récidive, etc.
Ces rapports rédigés par les SPIP sont un outil très utile pour fixer la peine la plus juste. Leur regard et leur analyse de la situation permettent de suggérer des mesures qui faciliteront, par la suite, la réinsertion de la personne condamnée. En communiquant à l'autorité judiciaire toutes les informations nécessaires à l’individualisation de la peine adaptée de la personne, ils évitent des sanctions désocialisantes qui pourraient être des freins majeurs à la réinsertion de l’infracteur. Leur éclairage permet aux magistrats de prononcer des mesures alternatives à l’emprisonnement telles que la semi-liberté, la Détention à domicile sous surveillance électronique (port d’un bracelet électronique, le Placement à l’extérieur, ou autres.
Le suivi SPIP en post-sentenciel
Le rôle des SPIP consiste alors à accomplir plusieurs missions comme celles d’assurer le suivi des mesures judiciaires de milieu ouvert, c’est-à-dire que les SPIP veille au respect des obligations ordonnées par le Juge d’application des peines, d’informer les autorités judiciaires du déroulement des mesures et si la situation se présente du non-respect des obligations.
Dans le cadre de la libération sous contrainte les SPIP ont un rôle similaire à celui joué en pré-sentenciel, en adressant au Juge de l’application des peines (JAP) un rapport avec des recommandations sur la mesure la plus adaptée, sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées, ou - éventuellement - signaler des raisons qui font obstacle à l'application de la libération sous contrainte.
Lorsque les personnes détenues sont en fin de peine d’incarcération les SPIP travaillent à la préparation de leur libération, afin de les faire sortir de prison avec un accompagnement, l’objectif étant de limiter les sorties sèches (c’est-à-dire sans accompagnement), qui entrainent un fort taux de récidive.
Comment se déroule un suivi des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ?
Le suivi SPIP sera différent selon si la peine à réaliser se déroule en milieu fermé ou en milieu ouvert.
En milieu fermé, c’est-à-dire au sein des établissements pénitentiaires, les SPIP agissent en lien avec le personnel de surveillance et de direction, et les autres acteurs de la prison : l'Administration pénitentiaire, les personnels de santé, les personnels d'éducation, les associations, les bénévoles, etc. Ces connexions permettent aux SPIP, via les Conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) une large palette d’actions. Pendant les rendez-vous avec les détenus suivis, ces derniers peuvent leur exposer leurs différents souhaits (travailler, voir un médecin) et soucis (mettre en place un échéancier, etc.). Ils accompagnent ainsi les personnes détenues dans leur parcours d’exécution de la peine d’emprisonnement sur tous les aspects de leur quotidien et de leur futur puisque les CPIP les aident à la préparation à la sortie de prison.
En milieu ouvert le suivi SPIP concernent les personnes condamnées à des peines alternatives à l'incarcération, bénéficiant d'aménagements de peine, ou exécutant des mesures pénales sans écrou. C’est-à-dire sursis probatoire, Placement à l'extérieur, Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ou Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) plus communément connues sous le nom de bracelet électronique, Travail d'intérêt général (TIG), libération conditionnelle, Semi-liberté, peines de stage, Placement sous surveillance judiciaire, Suivi socio-judiciaire, Réduction conditionnelle de peine. Ainsi que d’autres mesures telles que le contrôle judiciaire, l’interdiction de séjour, etc. Pour assurer ce suivi, les SPIP organisent des rendez-vous individuels entre la personne et son Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) en charge de son dossier, et également des ateliers collectifs en travaillant en lien avec un réseau de partenaires, dont l’Îlot fait partie, dans les domaines du soin, de l’hébergement ou de l’insertion professionnelle afin de pouvoir agir sur tous les aspects du suivi.
Combien de temps peut durer un suivi des services pénitentiaires d'insertion et de probation ?
La durée d’un suivi SPIP est conditionnée à la situation judiciaire de la personne dès qu’elle a le statut de prévenu, puis de condamné et ce jusqu’à ce qu’elle ne soit plus sous main de justice. Cela pourra donc varier de quelques mois à plusieurs années, selon la gravité du délit ou du crime commis.
Que se passe-t-il si on manque à ses obligations pendant un suivi SPIP ?
La mission principale des SPIP est de favoriser la réinsertion et limiter la récidive. Les SPIP se doivent de veiller à ce que les personnes suivies respectent leurs obligations imposées par le jugement. Les manquements constatés font alors l’objet de rapports au magistrat. Selon la gravité du non-respect et du profil de la personne concernée, le magistrat peut décider de l’incarcération pour éviter le risque de récidive et garantir la sécurité des victimes.
L’Îlot qui accueille dans ses dispositifs d’hébergement et de retour à l’emploi des personnes sous main de justice travaille étroitement avec les SPIP des régions où nous sommes implantées. Notre Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Chemin Vert a été le premier CHRS à accueillir des hommes en Placement à l'extérieur. Depuis hommes et femmes sortant de prison ou encore sous main de justice sont présents dans tous nos dispositifs d’hébergement, de retour à l’emploi et de suivi de soins.
En 2024, le public justice représente 60 % du public accueilli à l'Îlot
Peine terminée 21 % :
o dans les 6 mois qui ont suivi leur sortie de prison ;
o après une condamnation par le passé non connue des équipes de l’Îlot.
Aménagement de peine 5 % :
o Semi-liberté (SL);
o Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE ou bracelet électronique) ;
o liberté conditionnelle ;
o Placement à l’extérieur (PE).
Peine principale ou complémentaire en dehors de la prison 4 % :
o suivi socio-judiciaire ;
o Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).
Peine alternative à la prison 64 % :
o Sursis probatoire ;
o Travail d’intérêt général (TIG) ;
o contrainte pénale.
Dans l’attente d’un jugement 5 % :
o contrôle judiciaire ;
o Assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ;
o prévenu.
(1) « Les décisions de justice à caractère pénal sont des jugements rendus par les tribunaux dans le cadre de procédures pénales. Elles concernent les infractions pénales et visent à sanctionner les auteurs de ces infractions. La justice pénale protège les intérêts de la société et des victimes en appliquant des peines et des mesures appropriées. Ces décisions peuvent inclure des verdicts de culpabilité, des peines d’emprisonnement, des amendes, des mesures de probation, etc. » justice.gouv.fr